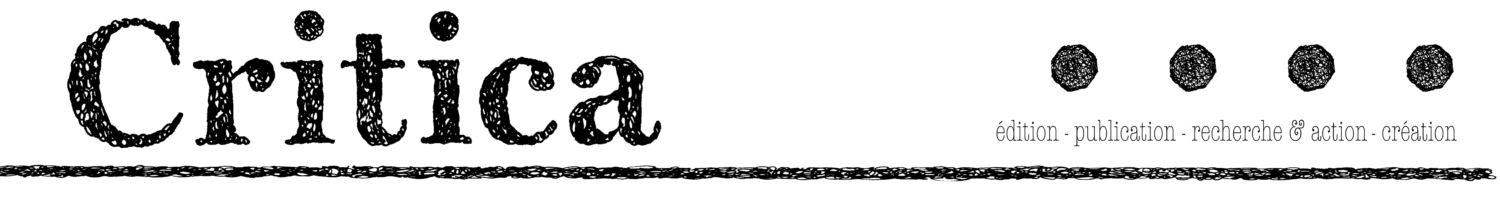Aux origines de Critica
A l’origine du lancement de la plateforme Critica se situe la décision de cesser la publication de la revue semestrielle Les Mondes du Travail. Après 31 numéros (2006-2024), faisant face à un déficit de soutien institutionnel interne au monde académique et une détérioration de la qualité des productions franco-françaises, un repli de la sociologie sur elle-même, la raréfaction d’une production fondé sur les paradigmes critiques (théorie critique, matérialisme historique), la décision a été prise de réinvestir les ressources dans un nouveau projet qui élargit le champ thématique à la critique de la modernité capitaliste en décloisonnant les questions du travail, de l’emploi et de l’action collective tout en s’ouvrant sur d’autres thématiques et en privilégiant une approche s’adressant à des sphères linguistiques non francophones ou anglophones.
Les sciences sociales en crise dans un monde en plein bouleversement
Les sciences sociales traversent une crise profonde. Celle-ci se mesure à l’aune du degré d’incompréhension que nous éprouvons en appréhendant un monde en plein bouleversement, suscitant tour à tour un sentiment de stupéfaction et de sidération face à des d’évènements qui tendent à se succéder de manière à la fois impromptue et prévisible.
Que ce soit la crise financière mondiale (2008-2009) ou la pandémie du COVID19, la démultiplication des guerres régionales – pouvant potentiellement conduire à l’embrasement généralisé – la crise climatique qui gagne en amplitude ou encore la perte biodiversité qui bouleverse les écosystèmes marins et terrestres, il est un fait que l’on ne peut plus ignorer : nous sommes entrés dans une époque de bouleversements et de crises systématiques qui tendent à s’amplifier et se renforcer mutuellement. Nul ne sait où cela nous mène dans une ou deux générations, ce qui est sans aucun doute l’aspect le plus paralysant ou anxiogène de notre époque.
Elle est loin, la croyance que la révolution technologique numérique et la société de la connaissance annonçaient l’avènement d’une nouvelle ère de prospérité. Bien au contraire, en moins de deux décennies, les inégalités sociales se sont creusées au point où la richesse des 1 % les plus riches de la planète correspond à plus du double des richesses de 90 % de la population mondiale, équivalent à peu de choses près 7,2 milliards de personnes. La majorité de la population mondiale vit désormais dans des espaces urbains, et des millions de personnes vivent dans l’insécurité alimentaire, sans eau potable, dans un environnement où la pollution de l’air comme celle des sols deviennent légion. Y compris le monde des pays « développés » (OCDE) voient les inégalités se creuser pendant que le « sud global » opte pour les migrations vers le « nord global », de gré ou de force, bravant les régimes de « frontiérisation » tout en n’ayant d’autre choix que de s’intégrer dans les régimes de travail marqués par la surexploitation et la coercition.
Les transformations sociales initiées depuis le début de l’ère néo-libérale ont longtemps été abordées en relativisant leur nature et leur portée. Le postmodernisme – cette culture du capitalisme tardif (Frédéric Jameson) devenue hégémonique lorsque la « fin de l’histoire » se proclamait à haute voix – a eu cette capacité de relativiser tout ambition de comprendre et d’expliquer ; à neutraliser sinon à marginaliser toute tentative de critique un tant soit peu systémique et globale, et surtout, à dissoudre les antagonismes et à dévitaliser les résistances collectives.
Les effets de longue durée d’une révolution néolibérale furtive
La révolution silencieuse néolibérale qu’évoque Wendy Brown, a poursuivi son entreprise de démantèlement du demos (peuple) en assujétissant la démocratie libérale à la gouvernance austéritaire de pendant que le processus de marchandisation universelle a continué à s’étendre, en intégrant progressivement l’ensemble des activités sociales et des écosystème naturels dans le maëlstrom de l’accumulation et de la valorisation jusqu’à leur futur épuisement tout en faisant abstraction des conséquences négatives irréversibles sur l’habitabilité de notre planète.
L’ampleur de ces bouleversements, leur accélération, l’incapacité des institutions – quelles qu’elles soient – à contrecarrer leurs effets destructeurs nous conduisent dans une situation sans issue apparente ; une situation où le sentiment d’impuissance prédomine tandis que les imaginaires sont saisis par des visions apocalyptiques du futur au lieu de questionner un système social pourtant en grande partie à l’origine des désastres qui se rapprochent.
Le besoin impérieux d’une réalisme critique
La crise des sciences sociales se mesure également dans leur incapacité à appréhender la réalité telle qu’elle est. Trop souvent, les évènements demeurent sous-estimés dans leur portée, au niveau des enchaînements qu’ils peuvent produire et de l’impact qu’ils peuvent avoir. Souvenons-nous de cette idée qu’après le COVID, « on changerait tout », et comment elle témoigne à la fois d’une naïveté désarmante et d’une incompréhension profonde de ce qui est en train d’advenir. Le 20ème siècle fut considéré par l’historien britannique Eric Hobsbawn comme l’âge des extrêmes, gageons que le 21ème est en train de devenir l’âge des désastres extrêmes.
La crise des sciences sociales se mesure enfin par leur incapacité à renouer avec une ambition critique dont l’objectif devrait être de mieux comprendre le monde afin de pouvoir a minima tenter de le transformer. Il existe néanmoins des différences notables d’un pays à l’autre, d’une aire linguistique à l’autre. Bien souvent, les créations artistiques ou littéraires réussissent mieux à exprimer, certes de manière métaphorique – mais quel langage ne l’est pas ? – une lucidité et une clairvoyance à propos de ce qui est en train d’advenir. Est-ce la liberté dont elle se défait difficilement qui fait que la création artistique semble mieux disposée à nourrir l’intelligence collective ?
Il est certain que la recherche scientifique produit aussi sa propre crise. Le régime de vérité positiviste a cédé la place à la raison instrumentale néolibérale qui se traduit par la poursuite incessante de « déliverables » (brevets, innovations au service la logique de valorisation et gadgétisation des résultats de la recherche ). Coincé entre le marteau des cures d’austérité et l’enclume d’une raison instrumentale, la recherche scientifique se laisse conquérir par le conformisme et les formes d’autocensure « à bas bruit ».
En France, peut-être davantage qu’ailleurs, les sciences sociales tendent à se fragmenter suivant une division disciplinaire ce qui finit par entraver toute velléité de compréhension globale et approfondie. La tendance à la surspécialisation suivant les objets et les thématiques se diffuse à peu près partout. La formalisation académique répond à cet impératif catégorique moral de l’excellence, ce qui au final, produit une désertification des communs du savoir et une régression de la compréhension réelle, tant du côté de la recherche que de la transmission des savoirs, tâche essentielle qui incombe au monde de l’enseignement qui se voit rudoyé en permanence par des réformes lui enlevant toute indépendance d’esprit.
L’évolution qu’a connu l’ESR depuis une vingtaine d’années n’est évidemment pas étranger à cette crise rampante des sciences sociales. L’université néolibérale, managériale et marchande génère une maladie auto-immunitaire où les dispositifs et les critères qui sont supposés favoriser une activité scientifique de qualité produisent au final le contraire : braconnage, plagiarisme, production sérielle d’articles dont la pertinence est d’autant plus relative que les analyses demeurent superficielles ou partielles.
Passer des contre-tendances aux contre-feux
Fort heureusement, il existe des contre-tendances et le monde de la recherche est riche en productions de savoirs critiques. Il n’en demeure pas moins qu’il se retrouve dans une situation d’isolement croissant, à se constituer comme champ autonome où prévalent les luttes symboliques et matérielles pour l’accès aux ressources et où prévaut, pour les cohortes de précaires, une incessante lutte des places. La quantification de la production (des publications aux nombre de thèses) et la classification des institutions conduisent le champ de la recherche à devenir de plus en plus auto-référentiel, sans liens avec les acteurs sociaux ni les enjeux sociétaux qui sont pourtant des plus pressants. En privilégiant un langage ésotérique et une scolastique disciplinaire, les sciences sociales ne parlent plus qu’à la petite communauté des pairs et s’isolent toujours davantage des mondes sociaux tel qu’il est vécu et perçu par la majeure partie de la population. Faut-il s’étonner qu’une telle involution laisse le champ libre à l’anti-intellectualisme et aux campagnes réactionnaires contre le « wokisme » ou « l’islamo-gauchisme » ?
Plusieurs ruptures seront nécessaires avant d’amorcer le virage
La première d’entre elles implique une rupture avec le formalisme académique qui agit comme un principe organisateur de sélection non-scientifique puisqu’il périphérise et disqualifie les savoirs qui ne font pas consensus, qui n’expriment aucune dissonance avec les dogmes et le sens commun de l’idéologie dominante.
La deuxième rupture implique le rejet d’un postmodernisme qui relativise toute velléité de connaissance approfondie et annihile toute volonté de compréhension scientifique, même contingente ou « de moyenne portée ». Suivant la logique du postmodernisme, tous les récits se valent autant les uns que les autres, ce qui, chemin faisant, ne fait qu’alimenter la confusion, le cynisme et le relativisme.
La troisième rupture implique de renouer avec une liberté de pensée dissidente, de retrouver le chemin de l’indépendance d’esprit et d’une pensée critique, tant au niveau des analyses que sur le plan des pratiques de la recherche afin de constituer des espaces où les modes de subsomption du travail intellectuel pourront être réduits à minima et où la rationalité instrumentale perd sa raison d’être.
Amorcer un tel virage n’est pas à prendre à la légère. Cela requiert un effort tenace et une réarticulation entre théorie et pratique, l’organisation d’un dialogue entre « savoirs savants » et « savoirs pratiques » en s’attelant à la construction d’outils et d’espaces qui font exister une activité collaborative qui assume ses liens avec les enjeux sociétaux et écologiques de la crise systémique de la modernité capitaliste tardive et la nécessité d’une bifurcation par rapport à la voie sans issue que nous avons désormais empruntée depuis plusieurs décennies.
S. Bouquin –Bruxelles / Paris / Montpellier – 21 décembre 2024.